Divergences UE/US transparence des entreprises en 2025
Alors que l’Europe consolide son leadership en matière de reporting extra-financier avec la CSRD, les États-Unis s’engagent dans une voie de dérégulation assumée. Ces divergences UE/US en matière de transparence des entreprises révèlent une fracture informationnelle inédite. Plus qu’un simple débat technique, elles redéfinissent profondément le rôle des professionnels du chiffre appelés à se réinventer pour rester les garants de la transparence et de la confiance.
Les signaux récents en attestent. Le 10 septembre 2025, Paul Atkins (SEC) exprimait ses préoccupations sur l’orientation de l’IFRS Foundation autour de l’ISSB. Puis, le 17 septembre, il allait plus loin en appelant à abandonner le soutien américain. Dans le même temps, l’EPA proposait, le 16 septembre, d’assouplir les règles de reporting carbone, avec une période de commentaires ouverte jusqu’au 3 novembre et une audience le 1er octobre. Le projet prévoit la suppression du GHGRP, censée générer 2,4 milliards de dollars d’économies sur huit ans.
De l’autre côté de l’Atlantique, l’UE maintient son cap avec la CSRD et la consultation des standards ESRS (ouverte jusqu’au 29 septembre 2025), malgré certaines inquiétudes exprimées par l’EFRAG.
Ces divergences ne sont pas simplement techniques. En fait, elles révèlent des approches philosophiques différentes de la transparence corporate. L’Europe maintient une vision holistique de la responsabilité des entreprises. Au contraire, les Etats-Unis semblent privilégier une approche plus strictement financière.
Dans ce contexte de fracture transatlantique, une question s’impose : comment les professionnels du chiffre peuvent-ils continuer à garantir la confiance des marchés ?
Divergences UE/US transparence des entreprises : Origines de la fracture transatlantique
Reporting financier : Transparence européenne vs flexibilité américaine
Si la question du reporting extra-financier concentre aujourd’hui l’attention, il ne faudrait pas sous-estimer l’importance des débats persistants sur le reporting financier traditionnel. En effet, les deux blocs semblent s’éloigner jusque dans leur manière d’appréhender la périodicité et la densité de l’information financière.
Etats-Unis
Aux États-Unis, le débat sur la pertinence du reporting trimestriel connaît en 2025 un regain de vigueur. Les partisans de son allègement, y compris, The Long-Term Stock Exchange (LTSE), avancent deux arguments principaux :
- D’une part, le coût administratif : produire un rapport complet tous les trois mois mobilise des ressources considérables, en particulier pour les entreprises de taille intermédiaire.
- D’autre part, le court-termisme : en focalisant l’attention des investisseurs et des analystes sur des résultats trimestriels, le système décourage les stratégies de long terme et incite à des arbitrages financiers dictés par des considérations immédiates.
Effectivement, le nombre d’entreprises cotées est passé de 8000 à 4000 depuis 2016.
Cette évolution soulève des questions cruciales pour les investisseurs. Moins de rapports signifient potentiellement moins de transparence immédiate. Toutefois, ils pourraient encourager des stratégies d’investissement plus réfléchies et moins spéculatives.
Union européenne
L’Union européenne poursuit sa stratégie de transparence réglementaire avec le Paquet Omnibus, qui vise à simplifier les obligations de reporting tout en maintenant des standards élevés. Cette approche équilibrée cherche à alléger la charge administrative des entreprises sans compromettre la qualité de l’information financière.
Cette approche contribue à entretenir un climat de confiance, même dans un contexte économique incertain.
De ce fait, les divergences UE/US en matière de reporting financier soulignent une convergence des objectifs, malgré des approches différentes. Ainsi, coexiste un modèle américain tourné vers la souplesse et un modèle européen attaché à la stabilité et à la rigueur.
Or, si le reporting financier affiche déjà des signes de divergence, c’est surtout sur le terrain extra-financier que le fossé se creuse de manière spectaculaire.
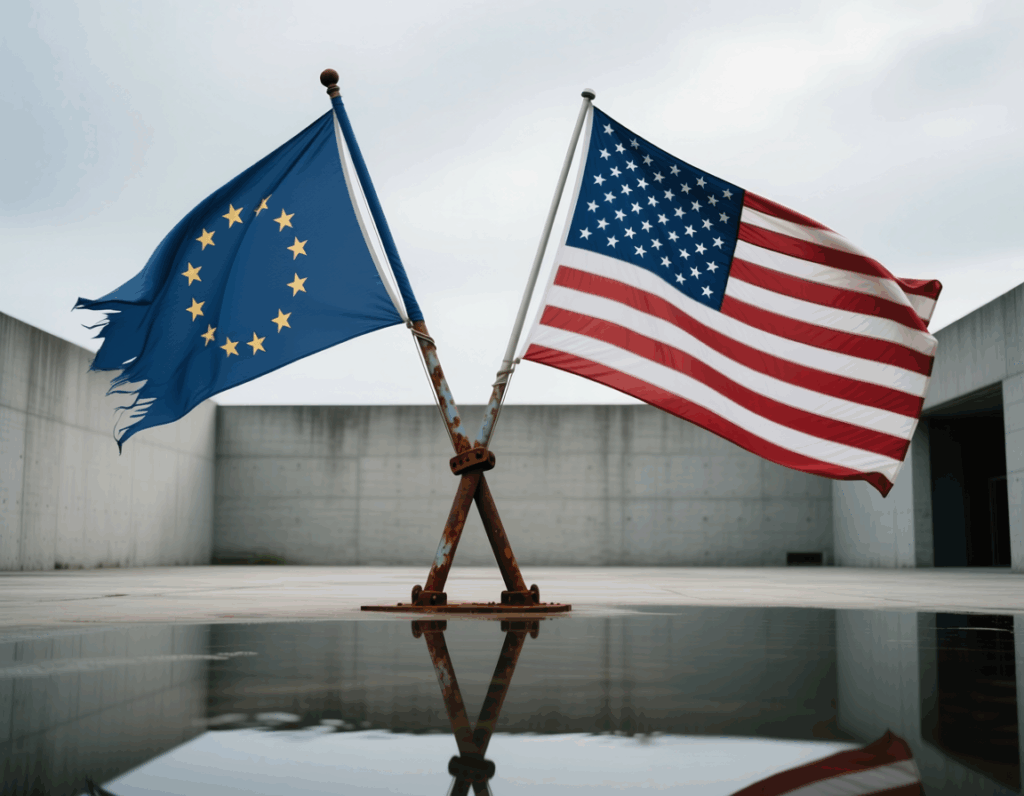
Reporting extra-financier : double matérialité en Europe, matérialité financière aux US
Ces divergences UE/US en matière de transparence des entreprises sont particulièrement visibles dans le reporting extra-financier. En effet, l’UE impose la double matérialité tandis que les Etats-Unis privilégient une logique de marché.
L’extra-financier est sans doute le miroir le plus révélateur des différences de philosophie entre l’Union européenne et les États-Unis.
Union européenne
Côté européen, la CSRD incarne une révolution : la double matérialité. En effet, elle impose aux entreprises de rendre compte à la fois de :
- l’impact de l’environnement sur leur activité (matérialité financière),
- l’impact de leurs activités sur la société (matérialité d’impact)
Ce choix traduit une vision holistique de la performance de l’entreprise, intégrant à la fois sa dimension économique et sa contribution positive ou négative au bien commun.
L’EFRAG confirme ce cap en consultant sur les normes ESRS mis à jour (septembre 2025).
Etats-Unis
Aux États-Unis, le paradigme est opposé :
- priorité à la matérialité financière stricte sous la pression de la SEC et l’EPA
- recours accru aux initiatives volontaires
En d’autres termes, seules les informations susceptibles d’avoir un effet direct sur la performance économique de l’entreprise doivent être communiquées.
La suppression annoncée du GHGRP par l’EPA illustre ce mouvement. Or, des ONG comme la Clean Air Task Force (CATF) qui y voient une menace de greenwashing.
Cette opposition reflète plus qu’une divergence technique : elle illustre deux visions du rôle de l’entreprise dans la société. L’Europe conçoit l’entreprise comme un acteur responsable, lié par un contrat implicite avec la collectivité. Au contraire, les États-Unis privilégient une conception centrée sur le marché, où l’information est avant tout un outil de valorisation économique.
Toutefois, un pont réglementaire existe. En effet, les normes ISSB (IFRS S1 et IFRS S2) représentent une tentative prometteuse de créer un langage commun du reporting de durabilité. Parallèlement, des initiatives volontaires comme le Global Reporting Initiative (GRI) contribuent aussi à renforcer la transparence et la comparabilité des rapports, en proposant un cadre flexible mais rigoureux.
Professionnels du chiffre face aux divergences UE/US en matière de transparence des entreprises
Ces divergences UE/US en matière de transparence des entreprises ne sont pas théoriques : elles posent les bases d’un casse-tête opérationnel pour les multinationales et leurs auditeurs.
Complexité des audits UE/US et risques accrus
Pour les auditeurs et comptables, ces divergences UE/US en matière de transparence des entreprises se traduisent par une complexité réglementaire démultipliée et des risques de non-conformité accrus.
Auditer des groupes implantés des deux côtés de l’Atlantique devient un exercice d’équilibriste. En effet, les professionnels du chiffre doivent gérer une double, voire triple compliance (IFRS, US GAAP, ESG).
Ce contexte engendre une véritable explosion des risques :
- En premier lieu, le risque de non-conformité : une information jugée suffisante de l’autre côté de l’Atlantique peut s’avérer insuffisante en Europe, exposant l’entreprise à des sanctions.
- En second lieu, le risque de greenwashing : en l’absence de cadre homogène, certaines sociétés pourraient être tentées de sélectionner les indicateurs les plus favorables, créant une illusion de durabilité.
- Enfin, un risque plus subtil mais tout aussi préoccupant émerge : celui des bulles d’actifs carbonés non détectées. En effet, si le reporting carbone perd en fiabilité aux États-Unis, les auditeurs risquent de sous-estimer l’exposition de certains secteurs aux transitions énergétiques, avec des conséquences financières potentiellement majeures.
Des exemples concrets viennent illustrer ce panorama. Le coût des audits pour les filiales transatlantiques ne cesse de croître car chaque référentiel impose des procédures spécifiques. De plus, selon certaines estimations, la suppression du GHGRP générerait certes 2,4 milliards d’économies brutes sur huit ans, mais pourrait aussi entraîner des coûts indirects estimés à 626 millions de dollars pour 2025 en raison des pertes d’information, notamment dans l’évaluation des risques climatiques.
Ainsi, les divergences UE/US en matière de transparence des entreprises imposent une nécessité stratégique d’adaptation pour la profession.

Nouvelles compétences pour auditer la transparence et le reporting
Pour prospérer dans ce nouvel environnement, les professionnels du chiffre doivent évoluer vers un profil d’auditeur intégré. Ceci implique de développer un arsenal de compétences inédites.
De multiples référentiels
D’abord, ils doivent maîtriser à la fois les US GAAP, les IFRS, mais aussi une mosaïque de référentiels ESG. La capacité à naviguer entre ces cadres divergents devient un atout décisif.
Une veille transcontinentale
Ensuite, la veille transcontinentale s’impose comme une compétence fondamentale. Les évolutions réglementaires se succèdent à un rythme effréné, comme en témoignent les récents agendas de l’ISSB (réunion des 24-26 septembre 2025 sur la biodiversité et les GHG). Développer une véritable agilité cognitive permet d’anticiper plutôt que de subir.
Transformation numérique
De plus, la transformation numérique redessine profondément les contours du reporting. En effet, l’IA ne se contente plus de traiter les données : elle les contextualise, les interprète et, surtout, elle les anticipe.
Les nouvelles plateformes combinant intelligence artificielle et blockchain permettent désormais un reporting en temps réel. Elles permettent ainsi de :
- transcender les frontières réglementaires
- réduire le risque de falsification.
Certaines entreprises expérimentent déjà ces innovations. Ainsi, Siemens a lancé en 2024 un pilote combinant IA et blockchain pour automatiser le reporting carbone de ses chaînes d’approvisionnement. De son côté, Salesforce a intégré des modules d’IA prédictive dans Net Zero Cloud. Ceci permet de simuler différents scénarios climatiques.
Ces initiatives montrent que la technologie ne soutient plus seulement le reporting. En fait, elle transforme la manière dont l’information est produite, interprétée et utilisée.
À titre d’illustration, les algorithmes de machine learning peuvent aujourd’hui détecter des risques ESG avec une précision inédite. Pour les auditeurs, cela constitue un outil de vigilance stratégique.
Ainsi, la maîtrise de ces technologies devient une compétence indispensable.
Conseiller stratégique
Enfin, le rôle de conseiller stratégique prend une dimension nouvelle :
- traduire la complexité réglementaire,
- accompagner les dirigeants dans leurs choix de reporting
- renforcer la communication avec les investisseurs
Dans un tel contexte, la formation continue s’impose pour rester à jour. Les auditeurs devraient d’ailleurs également développer des compétences en science des données.
Implications éthiques de l’IA dans le reporting
L’adoption croissante de l’IA dans le reporting soulève des questions éthiques cruciales. Les algorithmes, souvent opaques, risquent de :
- introduire des biais subtils dans l’évaluation des risques ESG
- masquer les logiques de décision sous-jacentes.
Un enjeu central émerge : qui assumera la responsabilité en cas d’erreur d’un modèle prédictif ? Les auditeurs sont désormais confrontés à un double défi : exploiter ces outils technologiques tout en garantissant leur traçabilité, leur explicabilité et leur neutralité.
À défaut d’une approche rigoureuse, la confiance recherchée pourrait se transformer en défiance compromettant ainsi la légitimité même du reporting. L’enjeu dépasse la simple utilisation technique : il s’agit de préserver l’intégrité et la transparence des systèmes d’information.

Conclusion : Divergences UE/US transparence des entreprises : Vers une nouvelle architecture de la confiance financière ?
En définitive, les divergences UE/US en matière de transparence des entreprises ne sont pas conjoncturelles : elles traduisent des visions structurellement opposées. Les professionnels du chiffre, garants historiques de la confiance, doivent devenir les architectes d’une nouvelle transparence.
Une piste innovante réside dans un modèle hybride et modulaire : un socle commun minimal de standards globaux, couplé à des adaptations locales contrôlées. Dans ce cadre, les technologies joueraient un rôle déterminant : plateformes interopérables, algorithmes de conversion entre référentiels, systèmes de notation comparables.
Les implications stratégiques sont majeures.
- Pour les entreprises : développer un reporting agile, investir dans des systèmes de collecte de données flexibles, anticiper les évolutions réglementaires.
- Pour les professionnels du chiffre : maîtriser plusieurs référentiels, développer une compétence de traduction réglementaire et intégrer les technologies d’analyse avancée.
Pistes de réflexion :
- Le rôle des investisseurs comme régulateurs privés : des acteurs comme BlackRock, CalPERS ou Norges Bank imposent déjà à leurs participations des standards ESG plus stricts que ceux de nombreux États. Les guidelines ISSG (raccourci pour les mises à jour de l’ISSB) du 1er septembre 2025 illustrent cette dynamique : une régulation « de marché » façonnée par les investisseurs eux-mêmes, que les auditeurs devront savoir anticiper et interpréter.
- L’émergence de clusters régionaux : un bloc Asie-Pacifique pourrait s’aligner sur l’ISSB, créant un paysage multipolaire.
- La technologie comme facteur de convergence ou de divergence : interopérabilité et blockchain pourraient unifier le reporting mais des infrastructures incompatibles risqueraient d’aggraver la fragmentation.
- Les risques de fragmentation technologique : si chaque bloc développe ses propres protocoles numériques, les coûts d’adaptation exploseront et la comparabilité des données s’érodera.
- La nécessité d’une éthique renforcée face aux risques d’opacité, notamment avec l’IA.
Pour aller plus loin :




